| |
L’univers de Tsai Ming-liang en huit longs métrages
2. « Vive l’amour »
《爱情万岁》
par Brigitte
Duzan, 11 juin 2012
|
Ce
deuxième film de
Tsai Ming-liang (蔡明亮)
développe un thème qui va devenir central dans ses
films suivants, la solitude des êtres dans
les villes modernes, soulignée par un rythme lent,
des séquences très longues et des dialogues réduits
à quelques mots assourdis par le brouhaha de la
foule et les bruits de machines, comme échappés par
lassitude de la bouche de personnages semblant
avoir perdu toute aptitude à parler, ou même toute
volonté de le faire.
On
retrouve Lee Kang-sheng (李康生),
alias Hsiao Kang, qui travaille ici pour une
entreprise de pompes funèbres et vend des niches de
colombarium. Ah Jung, lui, est un petit vendeur à la
sauvette de vêtements de femmes qu’il tente de
vendre la nuit, dans une rue en face d’un grand
magasin. Un nuit d’hiver, ils s’introduisent dans un
appartement vide que tente en vain de louer une
employée d’une agence immobilière du nom de May Lin,
interprétée par une autre actrice que l’on
retrouvera dans des films ultérieurs de Tsai
Ming-liang, Yang Kui-mei (杨贵媚). |
|
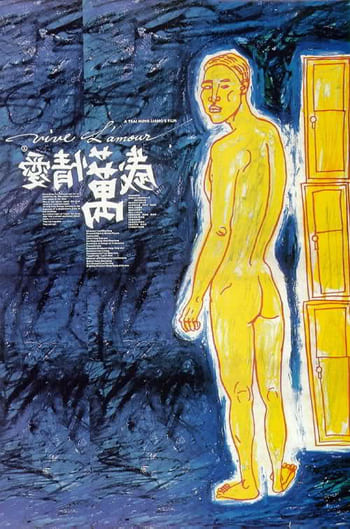
Vive l’amour |
|

Scènes du film 1 |
|
Ce sont
trois personnages solitaires et quasiment mutiques,
dont la caméra traque les gestes simples, souvent
ambigus, traduisant une sorte de langueur, faite de
répétitions monotones, qui contraste avec les
émotions houleuses mais contenues que la caméra nous
laisse deviner. Ainsi, dans l’une des dernières
scènes (dont on trouvera des échos dans d’autres
films, en particulier dans
« I
don’t want to sleep alone » (《黑眼圈》),
Hsiao Kang se glisse dans le lit de Ah Jung
endormi ; la caméra s’attarde longuement sur les
deux corps côte à côte, captant le lent mouvement de
Hsiao Kang qui se rapproche peu à peu de l’autre,
son visage traduisant un flot d’émotions
contradictoires, et finit par embrasser délicatement
l’endormi, sans l’éveiller.
Le film se
termine par une autre scène muette, mais tout aussi
expressive. May Lin marche vivement dans un parc,
|
|
après
avoir passé une de ces nuits avec Ah Jung qui la
laissent frustrée et lui font encore plus ressentir
sa solitude. Elle s’assoit et se met à pleurer. Tsai
Ming-liang fixe sa caméra devant elle et l’observe
sans plus bouger, c’est une de ses techniques
favorites. La séquence dure plus de cinq minutes,
c’est très long, mais c’est une scène d’anthologie :
l’actrice pleure, arrête un instant, recommence à
sangloter, apparemment sans réussir à trouver le
moyen de se consoler. On a l’impression que cela
pourrait durer éternellement : une douleur sans fin,
inexprimable et sans issue…
Ce torrent
de larmes est à l’image même des personnages de Tsai
Ming-liang, perdus, comme enterrés dans des mondes
clos, incommunicables, dans des sortes de villes
fantômes régulièrement englouties sous des eaux plus
ou moins mystérieuses, et où l’existence est une
survie douloureuse. C’est bien l’atmosphère
déliquescente des deux films suivants. |
|
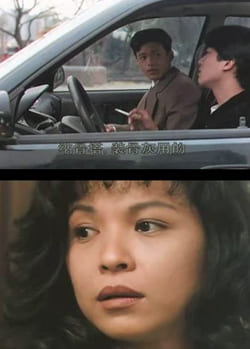
Scènes du film 2 |
 |
|
Le
film a obtenu le Lion d’or au festival de Venise en
1994.
|
Le film (1ère
partie)
Séquence finale
|
|