| |
« Lan Yu », un mélodrame subtil de Stanley Kwan
par
Brigitte Duzan, 15 septembre 2021
|
« Lan Yu » (《蓝宇》)
est un film superbe de
Stanley Kwan (关锦鹏)
sorti à Hong Kong en novembre 2001 et à Taiwan le
mois suivant. En Chine continentale, il a été très
vite évacué des écrans pour sauver l’intégrité de
l’amnésie nationale autant que la morale : le film
traite en effet d’une liaison homosexuelle sur fond
du spectre de Tian’anmen. On aurait pu trouver des
compromis sur la morale, car après tout la
conclusion du film est « positive », comme on dit,
mais sur Tian’anmen on ne transige pas.
Si le film est passé en Chine aux oubliettes, comme
tant d’autres, il reste cependant l’un des meilleurs
de Stanley Kwan, applaudi partout à l’étranger. Il a
été présenté en mai 2001 au festival de Cannes, dans
la section officielle Un certain regard.
C’est un mélodrame au meilleur sens du terme.
Genèse du film
« Lan Yu » est adapté d’un roman publié sur |
|

Lan Yu, l’affiche de
Cannes |
internet en 1998, mais on devrait plutôt parler de libre
inspiration, car le scénario suit bien dans ses grandes
lignes la narration du roman, mais l’esprit en est différent
et l’approche plus subtile.
Le
roman et ses différentes versions
Le
roman a été publié sur internet en 1998, révisé pour
publication à Taiwan, réécrit dans une version plus longue,
et traduit vingt ans plus tard en anglais et en français
.
C’est un roman qui garde son mystère car on ne sait toujours
pas qui l’a écrit
.
L’auteur.e s’est choisi un pseudonyme neutre : Bei Tong (北同),
premiers caractères de Beijing Tongzhi (北京同志),
tongzhi, ou camarade sous Mao, étant le terme adopté
par la communauté homosexuelle chinoise pour désigner l’un
de ses membres. Ce nouvel usage qui pouvait sembler ironique
au départ a été lancé en 1989 quand a été créé le Hong Kong
Lesbian and Gay Film Festival (xianggang tongzhi yingzhan
香港同志影展) et
que l’un des fondateurs, le dramaturge Edward Lam (林奕華)
,
l’a utilisé dans le titre chinois du festival
; c’était alors une véritable résurrection du mot, tombé un
peu en désuétude
.
Le
traducteur américain, Scott E. Myers, a mené une véritable
enquête sur l’auteur.e, qu’il raconte dans sa note
introductive à sa traduction parue à New York. Dans cette
note, il opte pour le féminin comme l’a fait Stanley Kwan,
mais sans être totalement convaincu, et sans révéler ce
qu’il a appris et a promis de ne pas divulguer. Ce qu’il y a
de sûr, c’est que Bei Tong était un.e Chinois.e vivant aux
Etats-Unis au moment de la publication du roman sur
internet. Initialement intitulé « Une histoire du
continent » (《大陆故事》),
c’est-à-dire de Chine continentale, le roman a été publié
sur un site internet de Chine continentale aujourd’hui
disparu qui s’appelait « Le paradis des hommes et des
garçons de Chine » (zhongguo nanren nanhai tiantang
中国男人男孩天堂).
Selon Scott Myers, la publication a débuté le 22 septembre
1998, ce qui en fait non seulement l’un des premiers romans
gays de Chine continentale, mais aussi l’un des premiers
romans chinois sur internet.
Le
texte lui-même est toute une histoire : il a été
littéralement reconstitué par Scott Myers à partir de trois
versions très différentes :
- La
première version – « Une histoire à Pékin » (《北京故事》)
- publiée en 1998 sur internet par Bei Tong, présente
les défauts caractéristiques des textes publiés sur
internet, coquilles et amateurisme, mais avec une exubérance
qui lui a valu ses premiers succès. Dans la postface de
l’édition révisée du roman publiée à Taiwan en 2002, Bei
Tong a expliqué les motivations qui l’ont poussé.e à
écrire : l’automne 1998 a été très difficile pour lui/elle ;
pour échapper à l’ennui et à l’angoisse du lendemain,
il/elle s’est immergé.e dans les jeux, les romans sur
internet et les sites pornographiques, trouvant tout cela
extrêmement médiocre et convaincu.e de pouvoir faire mieux.
Le roman est parti de là. La narration plane entre rêve et
réalité, réalité et fiction. Bei Tong a même brouillé les
pistes des lieux où se passe le récit. Le texte comporte 31
chapitres et un épilogue (尾声).
|
- La deuxième version est celle de
l’édition taïwanaise révisée de 2002,
intitulée « Lan Yu » (《蓝宇》)
et publiée après la sortie du film de Stanley Kwan.
Celui-ci avait entendu parler du roman par le
producteur Zhang Yongning (张永宁)
qui l’avait lu sur internet et s’était mis lui-même
en quête de l’auteur. C’est lui qui sera le
producteur exécutif du film (监制).
La couverture du livre était illustrée d’une photo
d’une séquence « chaude » du film et portait une
mise en garde pour en déconseiller la lecture aux
jeunes de moins de dix-huit ans. Les scènes de sexe
très explicites de la version internet étaient
cependant édulcorées et remplacées par des scènes de
plaisir sensuel évoqué, à la chinoise, par des
euphémismes.
- Peu après cette publication, Bei Tong a écrit une
troisième version, bien plus longue,
dans l’espoir de réussir à publier le roman en Chine
continentale – espoir vain car aucun éditeur n’a
accepté le manuscrit. Cette version comporte neuf
nouveaux chapitres, outre ceux de la version
initiale, soit au total quarante chapitres et un
épilogue, mais, comme |
|

Lan Yu, édition
taïwanaise du roman, 2002 |
l’intention était de publier cette version en Chine
continentale, le contenu sexuel explicite a été gommé.
En
accord avec Bei Tong, Scott Myers a basé sa traduction sur
cette troisième version, mais en réintégrant les scènes de
sexe de la version internet, et certaines des révisions
effectuées pour la version taïwanaise.
La
ligne narrative et les deux personnages
Le
roman débute par une rencontre, à l’automne 1987, entre Chen
Handong (陈捍东),
le narrateur, un homme d’affaires quasiment autodidacte qui
a fait fortune dans la Chine de l’ouverture, dans les années
1980, et Lan Yu (蓝宇)
un jeune étudiant en architecture juste arrivé à Pékin, sans
un sou ni relations. Le récit commence comme une simple
histoire de sexe tarifé entre deux hommes et évolue peu à
peu en une passion dévorante où apparaissent deux tendances
contradictoires : l’importance croissante de l’argent,
d’une part, mais aussi, de l’autre, la fascination pour les
idées libérales et la résistance à l’idéologie officielle
qui est également résistance aux conceptions traditionnelles
du genre et de la sexualité.
Les
deux personnages sont marqués et définis par ce contexte
politique. Handong est le fils unique d’un cadre qui a fait
du prénom de son fils une profession de foi, souvenir d’une
ère de fanatisme aveugle : han protéger, dong
pour Mao Zedong ; il obéit maintenant au diktat de l’heure :
enrichissez-vous. Lan Yu, lui, est dans la mouvance
estudiantine, rebelle et contestataire ; il participe aux
manifestations des étudiants sur la place Tian’anmen et
devient le témoin de la répression sanglante du mouvement
étudiant.
|

Beijing Comrades,
tr. Scott E. Myers,
2016 |
|

Lan Yu, Beijing Gushi,
traduction en
japonais, 2003 |
C’est
un tournant fondamental dans la narration, qui occupe tout
un chapitre. La répression devient un catalyseur affectif
qui entraîne la réunion des deux amants. Mais Lan Yu reste
fidèle à lui-même et à ses idéaux : honnête et pur jusqu’à
dépenser toutes ses économies pour faire sortir Handong de
prison quand celui-ci est incarcéré pour corruption, et même
jusqu’à refuser de circuler en taxi. Le jour où il renie son
idéal d’intégrité (légué par sa mère) et qu’il finit par
prendre un taxi, symbole de la nouvelle liberté offerte par
la richesse économique du pays, il est tué dans un accident.
Autant
les descriptions de scènes de sexe entre les deux hommes
sont explicites, autant tout ce qui concerne les événements
politiques est traité sur le mode allusif et symbolique, à
commencer par la mort du père de Handong, à la veille de la
répression, comme signalant la fin d’une époque.
Le
roman est particulièrement intéressant, dans sa version
longue, pour la peinture de l’atmosphère de l’époque, avec
la course à l’argent et l’inévitable corruption qui en
résulte, mais aussi pour les portraits des personnages
secondaires qui gravitent autour des deux hommes, et en
particulier la mère de Handong, typique à la fois de son
époque et de son milieu : c’est le personnage le plus vrai
et le plus attachant, ne reculant devant rien pour écarter
Lan Yu de son fils, mais finissant par reconnaître la force
de l’attachement qui les liait une fois Lan Yu disparu. Trop
tard, comme lui dira amèrement son fils.
En
fait, l’un des thèmes du roman est l’impossibilité pour
Handong et Lan Yu d’avoir une relation au grand jour, ce qui
finit par la condamner, et condamne en même temps Lan Yu
dont la mort est évidemment symbolique.
C’est
ce qui a intéressé Stanley Kwan et l’a convaincu d’adapter
le roman, en laissant de côté les scènes de sexe très crues
reprises de la version internet.
Le film de Stanley Kwan
Un
film chargé d’émotion
|
Le film est d’une toute autre tonalité que le roman.
C’est un grand film de Stanley Kwan, réalisé après
son documentaire de 1996, « Yang + Yin » (《男生女相》),
qui marquait un tournant dans sa carrière puisqu’il
accompagnait sa révélation de son homosexualité.
Il poursuit dans « Lan Yu » sa réflexion sur son
orientation sexuelle et son identité, sur son
éducation et ses contraintes familiales et sociales.
Il a retrouvé dans le roman des personnages et des
détails de sa vie personnelle.
La tonalité du film est toute en douceur et en
affectivité. Stanley Kwan a déclaré dans diverses
interviews qu’il avait été repoussé par la crudité
des scènes érotiques des deux premiers chapitres du
roman, dès le début de sa lecture ; ce n’était pas
du tout ce qu’il voulait faire. Il y a une violence
physique, une brutalité dans le roman que l’on ne
ressent à aucun moment dans le film. Jouant sur
l’allusion, celui-ci en |
|

Lan Yu, VCD du
film |
est
d’autant plus subtil, représentatif de l’art de Stanley Kwan
de brosser des portraits tout en finesse de personnages
ambigus et fragiles.
|

Tonalité du film |
|
Parmi ceux-ci, Lan Yu est l’un des plus beaux :
doublement marginal et « déviant », pour être à la
fois homosexuel et dissident, mais gardant jusqu’au
bout la pureté de l’idéal qui a poussé ses camarades
à manifester sur la place, et à s’y sacrifier. Il
apparaît victime non tant de la reprise en main du
régime, que de la fin des illusions de sa génération
dont la voix a été étouffée. Privé d’identité
politique, en équilibre économique instable et en
résidence précaire dans la capitale, il ne lui reste
que sa sexualité pour toute identité, et comme
unique moyen d’expression puisque |
les
autres ont été réduits au silence, sous la chappe de plomb
qui s’est abattue sur le pays.
C’est
un silence pesant, couvrant une violence latente, même si
elle est réprimée et muette – on croit la voir percer,
parfois, sous le voile de tristesse qui semble habiter Lan
Yu, jusqu’à sa mort. Mort qui clôt le film, non le roman, et
prend une signification différente dans les deux cas.
|
- Dans le roman,
Lan Yu meurt dans l’accident du taxi. Son souvenir
ne cesse de hanter Handong qui a réussi à partir au
Canada où il s’est remarié – le récit se termine à
Vancouver, par un beau jour d’automne, trois ans
après la mort de Lan Yu. Handong est rentré dans la
norme sociale, Lan Yu est trahi, mais c’est
finalement la victoire de l’argent autant que de la
société, et elle laisse un goût amer – le roman est
|
|

Le chantier où plane
l’ombre de Lan Yu |
un
mélodrame du néolibéralisme à la chinoise, où subsistent les
normes sociales traditionnelles supposées préserver
l’harmonie et la cohésion sociales et d’où la politique est
évacuée. Mais la survie, quand même, après Tian’anmen et
après la mort de Lan Yu, passe par l’exil, où peut
éventuellement renaître une utopie.
-
Dans le film, la mort de Lan Yu est différente : il
meurt dans un accident sur l’un des chantiers de la capitale
sur lequel il travaillait en tant qu’architecte – mort aussi
brutale que dans le roman, mais suggérant une dimension
symbolique autre : dans la dernière séquence, Handong passe
en voiture devant le lieu de l’accident, et ralentit comme
il fait toujours en passant là, où plane toujours l’ombre de
Lan Yu. Puis il continue sur fond de paysage urbain où se
dresse une multitude d’autres chantiers, accompagné par la
chanson « How could you allow me to be sad ? ».
|

Hu Jun dans le rôle de
Handong |
|
La tristesse, en effet, n’est plus de mise : le
paysage témoigne de la résilience de la cité
renaissant des cendres du passé, après avoir pansé
ses plaies et soigné ses cicatrices, y compris
celles de juin 1989. C’est le contrat que Deng
Xiaoping a offert au peuple chinois : la croissance
contre la liberté, toutes les libertés, du corps
comme de l’esprit. Il n’y a plus d’espoir, plus
d’idéal possible autre qu’économique, l’avenir est
balisé.
Le film de Stanley
Kwan ajoute cependant une dimension symbolique
supplémentaire, |
en
filigrane : il se passe à Pékin, où il a été tourné sans
autorisation
,
mais reflète aussi les tensions sensibles à Hong Kong au
même moment, la brutale répression de Tian’anmen étant venue
aviver les angoisses nées de la perspective de la
rétrocession de la colonie britannique
à la Chine, annoncée en 1984 pour 1997.
Sur le film planent deux ombres : celle de Lan Yu et celle
de la rétrocession. C’est assez pour en faire un film tabou.
|
Il a pourtant été projeté à l’université de Pékin en
décembre 2001, juste après sa sortie à Hong Kong et
à Taiwan, dans le cadre du Beijing Queer Film
Festival (北京酷儿影展),
premier festival de films LGBT en Chine, fondé en
2001 par l’écrivain et réalisateur gay
Cui Zi’en (崔子恩).
Le film a fait salle comble malgré l’absence de
publicité.
Une remarquable interprétation
Film intimiste, « Lan Yu » est remarquable pour ses
qualités artistiques et techniques, et |
|
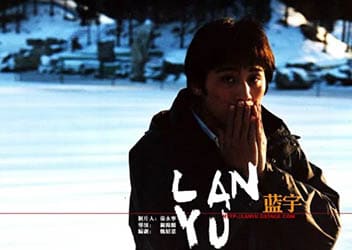
Liu Ye dans le rôle de
Lan Yu |
pour
sa volontaire non-dramatisation. Stanley Kwan a filmé des
mélodrames avant « Lan Yu », et il était conscient de la
ligne fragile qu’il y a entre mélodrame et soap opera.
Depuis le scénario jusqu’aux options techniques, souvent
dans des ambiances sombres, le film joue sur les émotions
tout en étant volontairement retenu.
|
Mais il est remarquable aussi pour l’interprétation
des acteurs dans leur ensemble, mais surtout celle
des deux principaux :
Hu Jun (胡军)
dans le rôle de Chen Handong, et
Liu Ye (刘烨)
dans celui de Lan Yu.
Le choix de Hu Jun paraît logique : c’est lui qui
interprétait le rôle du policier dans « East
Palace, West Palace » (《东宫西宫》)
en 1996. Le choix
de l’acteur apporte en outre en filigrane une nuance
qui rejoint le caractère de Handong dans le roman
par la simple suggestion de la résistance du
policier au charme qui émane de son détenu dans le
film précédent. Handong est un personnage ambigu,
toujours en lutte contre son attirance envers Lan
Yu, et finit d’ailleurs à la fin par le trahir en se
mariant.
Liu Ye a été choisi après un long casting ; son jeu
est d’une grande finesse. Il a été récompensé par le
prix du meilleur acteur lors de la 38ème
édition du festival du Golden Horse. |
|

William Chang |
|

Jimmy Ngai |
|
Stanley Kwan a dit que les deux acteurs avaient tout
de suite accepté sa proposition, et il s’en est
montré lui-même étonné, justifiant leur acceptation
immédiate par la qualité de l’équipe du film, en
particulier Jimmy Ngai (魏绍恩) pour
le scénario et William Chang (张叔平),
collaborateur régulier de Wong Kar-wai entre autres,
pour la direction artistique et le montage. Mais il
est certain que, bien plus encore, c’est l’attrait
de travailler avec lui qui les a motivés. |
[Article
rédigé pour la présentation du film à la séance de lancement
du programme 2021-2022 du ciné-club Le 7e genre
au cinéma Le Brady, le 27 septembre 2021]
En anglais : Beijing Comrades, tr. Scott E. Myers,
with translator’s notes, postscript to the revised
Taiwan edition by Bei Tong and afterword by Petrus
Liu, The Feminist Press at the City University of
New York, 2016.
En français (traduction de la traduction anglaise) :
Camarades de Pékin, Calmann Levy, 2018.
Après un film dont on a peu parlé, « Hold You
Tight » (《愈快乐愈堕落》),
qui a pourtant obtenu le prix Alfred Bauer et l’Ours
du meilleurs film gay/lesbien à la Berlinale en
février 1997, et après « The Island Tales » (有时跳舞)
en 1999.
|
|