| |
Fei Mu 费穆
1906-1951
Présentation
par Brigitte
Duzan, 22 octobre 2012
|
Fei Mu (费穆)
est l’auteur du film qui figure en tête de toutes
les listes des meilleurs films chinois :
« Printemps
dans une petite ville » (《小城之春》).
Malheureusement, il est mort trois ans plus tard, à
l’âge de 45 ans…
Venu au
cinéma dans la Shanghai des années 1930, il a, comme
ses confrères, traduit dans ses œuvres ses
préoccupations concernant les problèmes
socio-politiques de son époque, mais il se distingue
par un sens aigu de la psychologie et le soin porté
à la peinture des caractères de ses personnages. Il
a su à merveille dépasser les poncifs de l’époque
pour porter un regard neuf sur l’art
cinématographique ; ses films sont le reflet de sa
sensibilité poétique et de son immense culture.
Un petit
comptable qui veut faire du cinéma
|
|

Fei Mu jeune |
Fei Mu (费穆)
est né en 1906 à Shanghai, dans un famille conservatrice,
originaire de Suzhou, qui lui inculque dès l’enfance le sens
des valeurs morales confucéennes. Amateurs, par ailleurs,
d’arts chinois traditionnels, ils transmettent à leur fils,
aîné de quatre enfants, leur amour de l’opéra, opéra Kun
bien sûr, mais aussi opéra de Pékin.
En 1916, la famille
déménage à Pékin. Fei Mu y fréquente un lycée français ; il
apprendra ensuite par ses propres moyens l’anglais,
l’allemand et l’italien, mais le français restera sa langue
étrangère privilégiée. Enfant studieux, passionné de
lecture, il lit tellement, le soir, dans l’obscurité, qu’il
s’abîme les yeux et perd presque l’usage de son œil gauche.
Diplômé en 1924,
malgré son désir de poursuivre une carrière
cinématographique, il doit cependant se plier aux directives
familiales : il entre comme comptable dans une mine de sel
du Hebei, puis, quatre ans plus tard, est embauché à Tianjin
dans une société financière à capitaux mixtes sino-français.
Pendant toutes ces
années, ses parents continuent de s’opposer à son souhait de
devenir réalisateur, mais il n’abandonne pas pour autant
l’espoir de pouvoir un jour faire du cinéma. En attendant,
il passe tout son temps libre à étudier la théorie et à lire
des revues cinématographiques, avec tant d’obstination et de
passion que ses parents finissent par céder.
1930 : Le pied à
l’étrier
|

Luo Mingyou |
|
En 1930, il
réussit à entrer comme rédacteur à la société
cinématographique Huabei (华北电影有限公司).
La Huabei,
créée en 1927 par
Luo
Mingyou (罗明佑),
était en fait, au départ, une société de
distribution de films ; en 1930, elle était à la
tête d’une vingtaine de cinémas dans le nord de la
Chine. Or, à la fin des années 1920, les films
distribués étaient en majorité américains, mais les
films américains étaient de plus en plus parlants ;
or les cinémas chinois n’étaient pas équipés pour
les projeter.
Prévoyant
une situation de crise, et plutôt que d’investir des
sommes importantes dans l’équipement nécessaire, Luo
Mingyou décide de se tourner vers la production de
films chinois muets. Sa société devient la première
société cinématographique chinoise à intégrer tous
les aspects |
de la production,
de la distribution et de la projection, mais contribue à
retarder en même temps le développement du parlant en Chine.
|
Fei Mu
devient donc rédacteur dans cette société, et, en
même temps, publie des articles et des critiques
dans divers journaux, tout en co-éditant la
revue cinématographique Hollywood (《好莱坞》电影杂志)
avec un autre grand pionnier du cinéma chinois,
Zhu
Shilin
(朱石麟).
Or, en août
1930,
Luo Mingyou s’associe à son ami
Li Minwei (黎民伟),
qui a de son côté des problèmes avec sa société, la
compagnie Minxin (民新电影公司),
pour créer la compagnie Lianhua (联华影业公司),
avec deux autres studios de |
|

Zhu Shilin |
Shanghai. C’est la
Lianhua qui va offrir à Fei Mu la possibilité de réaliser
son rêve : passer derrière la caméra.
|

Ruan Lingyu dans
Une mer de neige
parfumée |
|
Son premier
film est, en 1933, « Une nuit en ville » (《城市之夜》),
qui dépeint la
lutte des
classes entre ouvriers et capitalistes,
suivi
l’année suivante de « La vie » (《人生》)
et « Une
mer de neige parfumée »
(《香雪海》),
trois films dont la vedette est la grande star de la
Lianhua,
Ruan Lingyu (阮玲玉).
|
1935-37 : Caméra au
poing
|
1. En 1935,
il réalise ensuite, en collaboration avec
Luo
Mingyou, un film qui fait date :
« Song of China »
ou
« Piété filiale » (《天伦》).
C’est l’histoire d’un père qui, déçu par un fils qui
tourne mal, fonde un orphelinat et reporte toute son
attention sur les enfants qui y sont recueillis ;
son petit-fils prendra sa relève à sa mort.
C’est
encore un film en noir et blanc, mais,
pour la première fois chez Fei Mu,
il est sonorisé et précurseur dans
l’utilisation de la musique chinoise. Surtout, il
représente un |
|

Song of China |
genre totalement
différent des films progressistes de l’époque : il prend la
défense des valeurs traditionnelles et prône la morale
confucéenne, dont l’amour universel.
On a dit que
c’était un reflet de l’éducation que Fei Mu avait reçue.
C’est surtout celui du « Mouvement pour une vie nouvelle » (新生活运动)
lancé l’année précédente,
en février 1934,
par le général Chiang Kai-shek (蒋介石)
et son épouse Soong May-ling (宋美龄)
pour tenter de contrer l'idéologie communiste (et la
corruption) avec un mélange de morale confucéenne, de
nationalisme et d'autoritarisme.
« Pitié filiale »
fut aussi l’un des rares films chinois à être diffusé aux
Etats-Unis, mais on en monta pour l’occasion une version
courte, avec intertitres anglais, d’un peu plus de 45
minutes.
|
2. Pendant
ce temps, la Chine est aux prises avec l’envahisseur
japonais qui progresse sur son territoire. En 1936,
Fei Mu réalise « Du sang sur la montagne aux
loups » (《狼山喋血记》),
histoire d’un village menacé par une horde de loups
que les villageois combattent unis. Evidemment
l’allégorie est transparente, mais surtout le film
tranche résolument sur ce qui se faisait à
l’époque : une histoire toute simple, « qui tient en
deux lignes », a dit Fei Mu, mais filmée en rupture
résolue avec le style théâtral usuel.
|
|
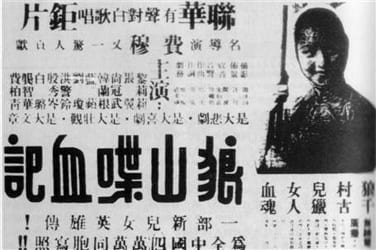
Du sang sur la
montagne aux loups |
|

Du sang sur la
montagne aux loups, une photo |
|
Pour la
petite histoire, outre les loups, Fei Mu dut
affronter la jeune actrice Lan Ping (蓝苹),
qui lui demanda de remanier le scénario pour qu’elle
ait un rôle plus important. Elle allait épouser Mao
deux ans plus tard, elle s’appelait en réalité Jiang
Qing (江青) ;
quand Fei Mu la retrouvera plus tard sur son chemin,
elle ne lui fera pas de cadeau…
|
3. L’année
suivante, en 1937, Fei Mu tourne l’un des huit sketches du
film « La symphonie de Lianhua » (《联华交响曲》),
intitulé « Rêve tragique d’un jeune fille » (《春闺断梦》).
Censure oblige, quand le film sort, il est muet.
4. Cette même
année 1937, Fei Mu filme ensuite un opéra, « Meurtre
dans l’oratoire »
(《斩经堂》),
interprété
par le célèbre Zhou Xinfeng (周信芳)
(1). Digne d’une tragédie de Shakespeare, ou d’une tragédie
grecque, l’histoire est celle d’un homme poussé par sa mère
à tuer sa propre épouse, car elle est la fille de l’assassin
de son père, qui est en plus usurpateur du trône... Fei Mu
revient ici, sous couvert de mise en scène d’opéra, à une
réflexion sur les liens et les conflits entre valeurs
morales et existence humaine, avec un sentiment de douleur
face aux pertes inévitables dues à la guerre.
Fei Mu a
expérimenté un mélange de naturalisme et de formalisme très
nouveau, en jouant sur la stylisation des rôles dans l’opéra
chinois. Il fut en fait poussé par Zhou Xinfang, qui insista
pour avoir des décors réalistes, tout en conservant les
codes et conventions de l’opéra (2).
En même temps
qu’il tourne le film, Fei Mu écrit le scénario d’une petite
comédie qui raconte les péripéties du tournage : la diva de
la troupe fiche le camp parce qu’elle n’a pas été payée
illico, un chanteur de rue la remplace… toute la fine
connaissance de l’opéra qu’avait Fei Mu apparaît dans ce
petit film d’à peine trente minutes : « On
Stage and Backstage »
/ « Sur scène et en coulisse » …
5. Toujours en
1937, il tourne encore deux films, « Une
ville plaquée or »
(《镀金的城》),
sur un scénario de
Hong Shen (洪深)
(la ville est évidemment Shanghai), et « Martyrs
sur le front du Nord »
(《北战场精忠录》) qui est un mélange d’actualités et de fiction, mais que l’on trouve
souvent classé parmi les documentaires.
Cette année 1937 est la fin d’un âge d’or pour le cinéma de
Shanghai. Le
7 juillet 1937, la guerre est déclarée. Pendant les quatre
années qui s’écoulent ensuite jusqu’à l'entrée des
Américains dans la guerre du Pacifique, en décembre 1941,
les concessions étrangères de Shanghai forment un îlot
fragile, cerné par l’occupant, où les cinéastes continuent à
travailler : l’ « île orpheline » (孤岛).
1940-1941 : Dans
« l’île orpheline »
|
Pour Fei
Mu, comme pour beaucoup de ses confrères, la période
de « l’île orpheline » est une période difficile
mais prolifique, pendant laquelle, en deux ans, il
tourne trois films et participe à un quatrième.
1. Le
premier est
« Confucius »
(《孔夫子》),
sorti fin 1940 après une longue gestation. C’est
un
chef d’œuvre, longtemps considéré comme perdu.
Fei Mu
dépeint le penseur à la fin de sa vie, comme un
prophète malheureux, méconnu de ses contemporains,
et victime d’une politique de conquête et de
compétition délétère entre Etats luttant pour
l’hégémonie. Le Confucius de Fei Mu est un homme
qui, finalement, est resté fidèle à ses idéaux, mais
des idéaux inadaptés à son époque, d’où son échec.
« Confucius, a dit Fei Mu, était voué à être une
victime de la politique de son temps. »
|
|

Confucius, le film
restauré |
|

Confucius, une scène
du film |
|
Le film a
miraculeusement refait surface il y a une quinzaine
d’années, offert par un donateur anonyme aux
Archives du cinéma de Hong Kong qui l’ont depuis
lors restauré en collaboration avec le laboratoire
spécialisé de Bologne. Au bout de ce long et patient
travail, fin 2008, les spécialistes de Hong Kong ont
alors découvert un film superbe, hiératique et
introspectif, reposant essentiellement sur des
dialogues, et filmé en tableaux en grande partie sur
fond de décors peints. |
Avec « Confucius »,
Fei Mu revisite les rapports entre théâtre et cinéma,
adoptant un style un rien cérémonieux qui souligne la
dignité qu’il a voulu donner au penseur. C’est un film
moderne à bien des égards (3).
2. L’année
suivante, en 1941, il apporte sa contribution à un travail
réalisé par un couple d’Autrichiens bloqués à Shanghai par
le déclenchement de la seconde guerre mondiale, Louise et
Julius Jacob Fleck. Leur film est intitulé « Les Enfants du
monde » (《世界儿女》).
Il est probable cependant que la contribution de Fei Mu se
soit limitée au scénario.
3. En 1941
toujours, il revient à ses amours premières, et réalise un
autre film d’opéra, ou plutôt d’extraits d’opéra : « Chants
de la Chine ancienne » (《古中国之歌》).
C’est une
sorte de réconfort dans un monde en guerre, un repli sur une
tradition culturelle qui prend d’autant plus de prix qu’elle
est menacée.
Puis il termine
l’année avec un dernier film avant longtemps : « Hong
Xuanjiao » (《洪宣娇》).
Il s’agit d’un film célébrant les valeurs nationales de
résistance face à l’ennemi : l’histoire se passe pendant la
révolte des Taiping ; pour venger son époux, un général des
Taiping tué au combat, Hong Xuanjiao part à la tête d’un
régiment de femmes se battre contre les Mandchous…
|
Dernier
film avant longtemps car, fin 1941, les Japonais
envahissent la totalité de Shanghai, mettent fin à
« l’île orpheline », et, en 1942, prennent le
contrôle des studios de cinéma. Fei Mu refuse de
collaborer avec eux et se consacre dès lors
uniquement à la mise en scène d’opéras, tout en
continuant ses recherches sur les possibilités de
fusion des arts traditionnels chinois (peinture et
théâtre) et de l’art cinématographique.
1948 : Bref
retour derrière la caméra
Il revient
derrière la caméra à la fin des hostilités, dans une
Shanghai en ruine, mais où le cinéma connaît son
« second âge d’or ». En 1947, il tourne « Le petit
pâtre » (《小放牛》), puis, en 1948, enchaîne
avec un autre film d’opéra qui est
|
|

Regrets éternels |
aussi le premier
film en couleur chinois :
« Regrets
éternels » (《生死恨》),
avec le grand Mei Lanfang (梅兰芳).
|

Le printemps d’une
petite ville |
|
Puis, en
1948, Fei Mu réalise ce qui reste un chef d’œuvre
absolu du cinéma chinois :
« Le
printemps d’une petite
ville » (《小城之春》).
Histoire qui aurait pu être banale d’un triangle
amoureux classique, mais filmée dans un monde clos,
au bord d’une muraille en ruine, et comme en marge
du temps, c’est un drame à peine évoqué, d’espoirs
déçus et de projets inaboutis, qui prend un sens
emblématique.
La
première du film, cependant, coïncide avec la
libération de Shanghai ; l’atmosphère sombre du film
ne correspond en rien à la liesse que suscite
l’événement. Le film est mis à l’écart ; il sera
ensuite critiqué pour sa « décadence
petite-bourgeoise », son caractère passéiste et son
« effet narcotique » sur le public. Il faudra
attendre les années 1980 pour qu’il soit redécouvert
et que de nouvelles copies soient tirées du négatif
d’origine. |
1949 Départ pour
Hong Kong
|
En 1949,
comme beaucoup d’autres cinéastes et intellectuels
chinois, Fei Mu s’enfuit à Hong Kong après
l’avènement du régime communiste. Avec
Zhu Shilin (朱石麟)
et Fei
Luyi, il y fonde une compagnie cinématographique :
la compagnie Longma (龙马影片公司).
En 1950,
cependant, il rentre à Pékin pour se mettre au
service du nouveau régime. Mal lui en prit : il est
accueilli avec la froideur qu’on imagine par nulle
autre que… Jiang Qing qui était alors responsable du
cinéma au département de la Propagande, et membre du
comité du cinéma au sein du ministère de la Culture.
Certainement déçu, Fei Mu repart à Hong Kong où il
entreprend un nouveau film : « Les enfants du
voyage » (《江湖儿女》).
Mais il n’aura pas le temps de le terminer, ce sera
Zhu Shilin qui l’achèvera : il meurt d’une crise
cardiaque le 30 janvier 1951… |
|

Les enfants du voyage |
Notes
(1) Moins connu
internationalement que Mei Lanfang, mais interprète renommé
de l’opéra de Pékin auquel il apporta nombre d’innovations,
Zhou Xinfang se tourna vers le cinéma dès les années 1920
pour en explorer les possibilités. Il était également un
grand ami de
Sang
Hu (桑弧).
Voir le site qui
lui est dédié :
www.zhouxinfang.com/eshengpin.htm
(2) Voir Le cinéma
chinois, sous la direction de Marie-Claire Quiquemelle et
Jean-Loup Passek, p. 175.
(3) Voir l’essai de
Wong Ain-ling (A lire en complément, ci-dessous)
Filmographie
1933 Night in the
City/Nuit dans la cité (《城市之夜》)
1934 The Life/La vie
(《人生》)
1934 A Sea of
Fragrant Snow/Une mer de neige parfumée (《香雪海》)
1935
Song of China
/
Piété filiale (《天伦》)
1936 Blood on Wolf
Mountain/ Du sang sur la montagne aux loups (《狼山喋血记》)
1937 Nightmares in
Spring Chamber/ Rêve tragique d’une jeune fille (《春闺断梦》)
[sketch du
film La symphonie de Lianhua
《联华交响曲》]
1937 Murder in the
Oratory/ Meurtre dans l’oratoire (《斩经堂》)
[opéra]
On
Stage and Backstage /
Sur scène et en coulisse
1937
Gold-Plated City/ Une ville plaquée or (《镀金的城》)
1937 Martyrs of
the Northern Front / Martyrs sur le front du Nord (《北战场精忠录》)
1940
Confucius
(《孔夫子》)
1941 Children
of the World / Les Enfants du monde (《世界儿女》)
[scénario]
1941 Songs of
Ancient China / Chants de la Chine ancienne (《古中国之歌》)
[extraits d’opéra]
1941 The
Beauty / La beauté (《国色天香》)
1941 Hong Xuanjiao
(《洪宣娇》)
1946 The
Magnificent Country / Le pays magnifique (《锦绣山河》)
1947 The Little
Cowherd / Le petit pâtre (《小放牛》)
1948
Regrets of
Life and Death /
Regrets éternels (《生死恨》)
[opéra]
1948
Spring in
a Small Town /
Printemps d’une petite ville (《小城之春》)
A lire en
complément
L’essai du critique
et chercheur Wong Ain-ling (黄爱玲) sur
« Confucius », dans le contexte de l’œuvre de Fei Mu : « The
Vicissitudes of History » (préface à son ouvrage « Un
réalisateur poète : Fei Mu » (《诗人导演——费穆》)
www.lcsd.gov.hk/ce/CulturalService/HKFA/graphics/publications/4-1-45_intro_e.pdf
|
|