| |
Wang Hanlun
王汉伦
1903-1978
Présentation
par Brigitte Duzan, 14 décembre 2018
|
Wang Hanlun est une actrice chinoise qui fut
extrêmement célèbre dans les années 1920, mais pas
seulement.
Elle représente une
période de transition dans le monde des actrices en
Chine : elle a commencé sa carrière en 1923, dix ans
après qu’un rôle féminin ait été tenu pour la
première fois par une actrice dans l’histoire du
cinéma chinois,
et pourtant la plupart des rôles féminins
continuaient à être joués par des hommes, dans la
tradition de l’opéra. Les actrices avaient encore à
subir des préjugés tenaces qui les assimilaient à
des femmes de vie légère et dissolue, d’autant plus
qu’elles étaient souvent divorcées. Elles étaient en
outre souvent exploitées.
Wang Hanlun a tenté de se libérer d’un système qui
ne lui permettait pas de s’épanouir en fondant sa
propre compagnie |
|

Wang Hanlun |
de
production : elle n’a produit qu’un film, mais elle a fait
fortune avec, puis elle s’est retirée comme si cela lui
suffisait d’avoir prouvé qu’une femme aussi pouvait avoir sa
propre compagnie.
Débuts à la Mingxing
De son
vrai nom Peng Jianqing (彭剑青),
Wang Hanlun (王汉伦)
est née en 1903 à Suzhou, dans le Jiangsu, Elle était la 7ème
enfant d’une famille aisée, et la seule fille, adorée par
son père. Elle fut donc envoyée étudier dans une école de
missionnaires pour filles à Shanghai, le collège
Sainte-Marie ; commençant à apprendre l’anglais, elle se
choisit pour prénom Helen. Mais la mort de ses parents
l’obligea à revoir ses ambitions.
A leur
mort, elle avait seize ans ; son frère la maria à un homme
qui travaillait pour les mines de charbon sino-japonaises de
Fengtian, aujourd’hui Shenyang, à des milliers de kilomètres
de Shanghai ; c’était un tel débauché que Wang Hanlun finit
par revenir à Shanghai. Comme son frère refusait de la
reprendre, elle trouva à se loger chez une parente éloignée
et commença une vie indépendante.
|

Wang Hanlun dans
« L’orphelin sauve son
grand-père » |
|
Elle enseigna d’abord dans une école primaire, puis
travailla comme dactylo dans une entreprise
étrangère filiale de la British American Tobacco. Or
l’un de ses collègues était actionnaire de la
compagnie Mingxing (明星影片公司)
et, en 1922, elle put grâce à lui visiter les
studios alors qu’on y tournait « La romance d’un
marchand ambulant » (《劳工之爱情》),
l’une des premières productions de la Mingxing,
réalisée par
Zhang Shichuan (张石川),
cofondateur de la compagnie.
Lui qui, jusque-là, n’avait travaillé qu’avec des
acteurs de théâtre trouva qu’elle avait l’allure
naturelle et les manières idéales pour jouer le rôle
principal du film qu’il était en train de préparer :
« L’orphelin sauve son grand-père » (《孤儿救祖记》).
Ayant passé le test avec succès, elle fut embauchée
avec un contrat lui promettant 500 yuan pour
le film et une allocation de 20 yuan par
mois. |
|
Jugeant que son attitude était une honte pour la
famille, son frère et sa belle-sœur la pressaient de
rentrer chez elle. Elle rompit tout lien avec eux et
prit un nom de scène. Comme les tigres portent sur
le front (en Chine) le caractère wang (王)
signifiant roi en témoignage de leur courage à toute
épreuve, elle prit le nom de Wang et pour prénom
Hanlun (汉伦)
dont la prononciation est proche de Helen.
Dans « L’orphelin sauve son grand-père », elle
interprète le rôle d’une femme courageuse qui perd
son mari, est calomniée et humiliée, mais continue
malgré tout à élever son fils : le type même de la
« femme nouvelle », économiquement indépendante et
assurant seule l’éducation de sa progéniture. Elle
eut la chance de tourner avec Zhang Shichuan, mais
aussi avec Zheng Zhengqiu (郑正秋)
qui travaillait en tandem avec lui et avait écrit le
scénario. |
|
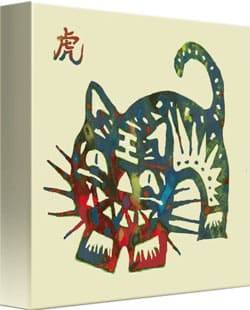
Le caractère wang
(roi) sur le front du tigre |
Le
film fut un grand succès ; la Mingxing en tira des bénéfices
qui la sauvèrent de la faillite, et lui permirent de tourner
aussitôt deux autres films, sortis en 1924 : « L’Âme de
Yuli » (《玉梨魂》),
adapté d’un roman de Xu Zhenya (徐枕亚)
publié en 1912, dans lequel elle interprète le rôle de Bai
Liniang (白梨娘)
aux côtés de
Yang
Naimei (杨耐梅),
et « Les Enfants pauvres » (《苦儿弱女》),
tous deux réalisés par Zhang
Shichuan sur un scénario
de Zheng Zhengqiu, mélodrames en noir et blanc dans
lesquels Wang Hanlun interprète deux autres rôles tragiques
de jeune veuve.
Elle
devient une star en vue, mais cela ne change pas pour autant
les conditions de son contrat ; la compagnie ne lui paya
même pas les vingt yuan mensuels qu’il stipulait.
Aussi, lorsque la compagnie de la Grande Muraille (长城画片公司)
- nouvelle compagnie progressiste, dont les membres avaient
étudié aux Etats-Unis - lui fait une offre très attrayante,
elle passe chez eux.
De la Mingxing à la Grande Muraille
Elle
tourne là trois films. Le premier – qui est aussi le premier
du studio - est « La Femme abandonnée » (《弃妇》),
coréalisé en 1924 par Li Zeyuan (李泽源)
et Hou Yao (侯曜),
sur un scénario de Hou Yao adapté de la pièce de théâtre
éponyme de Li Zeyuan. Le rôle principal de Zhifang (芷芳)
– influencé par la Nora d’Ibsen - est ici celui d’une femme
abandonnée pour une autre femme par son mari. Elle s’enfuit
avec sa servante Cailan (采兰),
interprétée par
Pu Shunqing (濮舜卿),
et finit par trouver un emploi dans une librairie. Les
difficultés et obstacles rencontrés, par elle-même comme par
Cailan, les incitent à se rapprocher du mouvement pour les
droits de la femme auquel elles prennent une part active.
Sur quoi le mari de Zhifang revient en tentant de se
réconcilier avec elle, ce qu’elle refuse. Il la calomnie
alors pour lui faire perdre son travail. Elle meurt dans la
misère dans un petit couvent de nonnes, en rêvant d’un monde
moins hostile aux femmes.
Le
film rencontra un grand succès, en particulier grâce à
l’interprétation des deux actrices, et contribua à la
notoriété de la compagnie. Il fut suivi en 1925 de deux
autres films dans le même genre de critique sociale axée sur
la place de la femme dans la société : « Entre amour et
devoir filial » (《摘星之女》)
et « Le Rêve du boudoir » (《春闺梦里人》),
tous deux réalisés par Li Zeyuan, mais le second coréalisé
avec Mei Xuechou (梅雪俦),
et dans les deux cas avec Wang Hanlun dans le rôle
principal.
En
dépit du succès commercial des deux films, elle ne réussit à
nouveau pas à se faire payer, intenta un procès à la
compagnie, le gagna, mais ne reçut qu’un chèque en bois en
compensation. Elle changea de compagnie, pour se faire
exploiter à nouveau, comme les femmes des films dans
lesquels elle jouait.
Constamment exploitée
|

En couverture de la
revue The Young Companion 《良友》(février 1926) |
|
En 1926, elle interprète le rôle principal dans
« Une bru vertueuse » (《好寡妇》)
produit par un studio éphémère, mais surtout elle
joue aux côtés des deux autres grandes actrices de
l’époque, Hu Die (胡蝶)
et Wu Suxin (吴素馨),
dans le grand succès de la Tianyi (天一影片公司) :
« Les actrices de cinéma » (《电影女明星》).
Wang Hanlun fait une tournée dans le sud-est
asiatique pour promouvoir le film. En raison de ses
rôles, elle est surnommée « la première dan
tragique de l’écran » (“银幕第一悲旦”),
en référence aux rôles féminins à l’opéra.
Elle joue encore
dans deux autres films sans être payée non plus.
Elle est considérée comme une actrice légèrement
scandaleuse, incarnant la femme moderne exhibant à
l’écran ses pieds non bandés.
Elle souffre des préjudices contre la profession
d’actrice, renforcés par le fait que les rôles de
figurants étaient tenus par des voyous et des
prostituées qui venaient là gagner quelques sous.
En 1927, elle est à nouveau exploitée lors d’une
tournée à Singapour financée par des hommes
d’affaires qui l’exhibent |
tout
en faisant payer les gens qui se précipitent pour la voir et
lui demander un autographe. Cette dernière expérience finit
de la convaincre de fonder sa propre compagnie.
La compagnie Hanlun
En
1928, elle décide de faire encore un film et de quitter
définitivement le monde du cinéma. Elle crée la compagnie
Hanlun (汉伦影片公司)
et achète un scénario au célèbre romancier et scénariste Bao
Tianxiao (包天笑) :
« L’amour aveugle » (《影场回忆录》),
ou « La revanche d’une actrice » (《女伶复仇记》).
C’était une histoire d’amour du genre « canards mandarins et
papillons », spécialité de Bao Tianxiao, avec une intrigue
reprenant l’idée d’amour libre contre les mariages arrangés
voulus par la tradition.
Elle
loue un studio à la Minxin, et engage le réalisateur
Bu
Wancang (卜万苍),
mais, comme il passe plus de temps sur le champ de courses
que sur le tournage, elle finit par réaliser le film
elle-même, et comme il n’est pas terminé au moment de rendre
le studio, elle achève le tournage chez elle avec l’aide de
Cai
Chusheng (蔡楚生),
alors encore assistant réalisateur. Puis elle monte le
film, ce qui lui prend encore quarante jours de travail.
Enfin,
pour faire la promotion du film, elle l’accompagne dans la
douzaine de villes où il est projeté, jusqu’à Changchun et
Harbin, puis part en tournée à Singapour, rencontrant le
public à l’issue des projections.
Ce fut
un succès. Elle gagna beaucoup d’argent, ce qui lui permit
d’arrêter le cinéma comme elle l’avait dit, en 1930, et elle
se lança dans le commerce en ouvrant un salon de coiffure.
Sa première cliente fut l’actrice Hu Die avec laquelle elle
avait tourné « Les actrices de cinéma » quatre ans plus tôt.
Le
salon lui rapporta beaucoup d’argent jusqu’à ce que Shanghai
tombe aux mains des Japonais en 1937. Elle ferma boutique
plutôt que de travailler pour les Japonais et disparut
pendant le temps de la guerre en vendant des meubles et des
vêtements pour vivre.
Retour au cinéma en 1950
Au
début des années 1950, à Shanghai, elle tente de revenir sur
la scène, mais sans réussir à s’adapter aux rôles de films
où dominaient soldats et ouvriers. En 1950, elle interprète
le rôle très bref de l’impératrice douairière Cixi (慈禧太后 )
dans
« La
Vie de Wu Xun » (《武训传》)
de
Sun Yu
(孙瑜).
Violemment attaqué, le film fut malheureusement la cible de
l’une des plus virulentes campagnes de Mao à l’époque et
ruina la carrière du réalisateur. Wang Hanlun ne jouait que
dans une courte scène, mais cela suffit. Elle disparut de la
scène pendant huit ans.
|
Elle refit une brève apparition en 1958 dans
l’avant-dernier film de
Sun Yu,
« La
légende de Lu Ban » (《鲁班的传说》),
puis la même année dans « La grande vague » (《热浪奔腾》)
de Tao Jin (陶金),
sur quoi elle fit ses adieux définitifs au cinéma.
Cela ne l’empêchera pourtant pas d’être attaquée au
début de la Révolution culturelle. Mais elle mena
ensuite une vie paisible et solitaire, en continuant
à recevoir une pension du gouvernement, et
s’éteignit en août 1978 à Shanghai, à l’âge de 75
ans. Elle était restée indépendante jusqu’au bout. |
|

Dans La légende de Lu
Ban, 1958 《鲁班的传说》 |
Resource documentaire
Wei, S
Louisa, "Helen Wang”,
In Jane
Gaines, Radha Vatsal, and Monica Dall’Asta, eds. Women
Film Pioneers Project. Center
for Digital Research and Scholarship. New York, Columbia
University Libraries, 2013.
En ligne :
https://wfpp.cdrs.columbia.edu/pioneer/helen-wang/
|
|